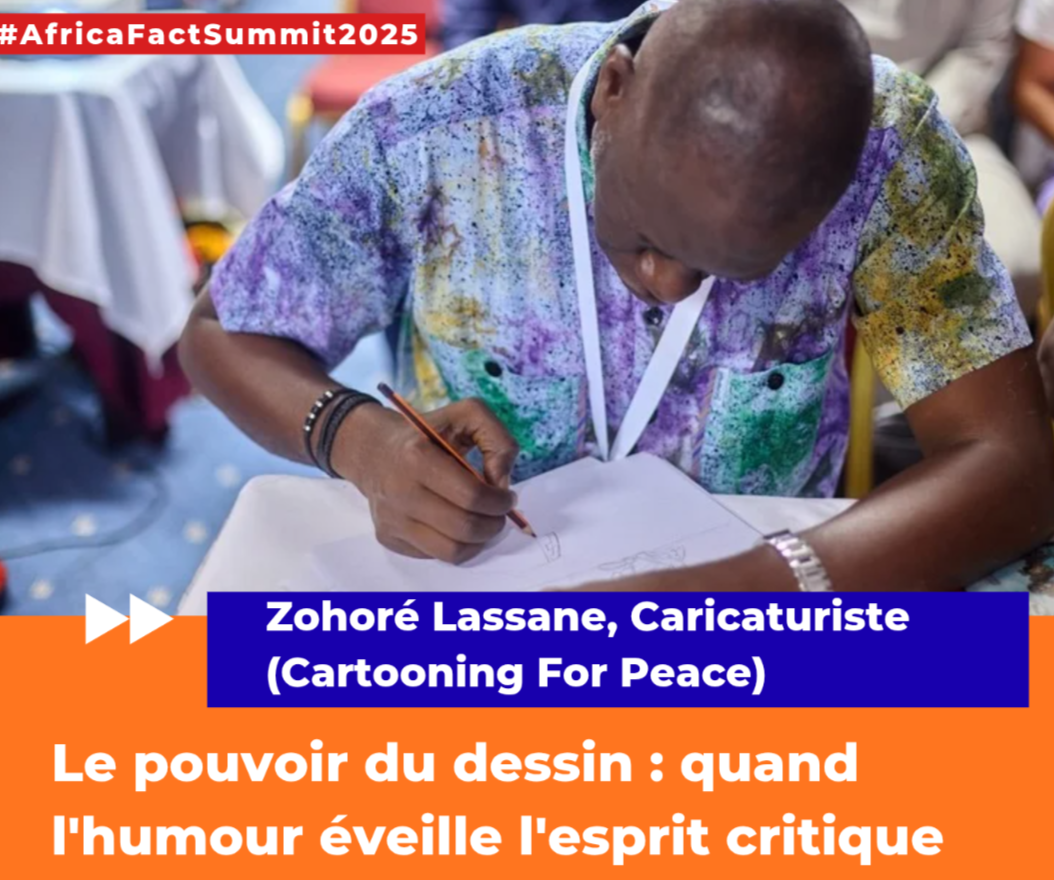Entre la rigueur finlandaise, l’esprit critique suisse, la coordination française et la participation belge, que peut apprendre le Cameroun pour construire son propre modèle d’éducation aux médias et à l’information ? Pourquoi l’éducation aux médias est urgente au Cameroun La désinformation circule plus vite que la vérité. Les jeunes camerounais grandissent connectés, mais rarement formés à décrypter ce qu’ils lisent, regardent ou partagent. Dans un environnement numérique saturé, l’esprit critique devient une compétence vitale. L’éducation aux médias et à l’information (EMI) n’est pas seulement une affaire d’école : c’est une question de démocratie, de paix sociale et de citoyenneté numérique. Et si le Cameroun regardait ce qui se fait ailleurs pour imaginer sa propre voie ? Ce que font les autres : 4 modèles inspirants La Finlande : l’esprit critique comme réflexe national Souvent citée en exemple, la Finlande a intégré l’EMI au cœur de son système éducatif. Chaque élève y apprend à vérifier les sources, analyser les intentions derrière les messages et comprendre le rôle des médias dans la démocratie. Ce n’est pas une matière isolée, mais un fil conducteur présent dans toutes les disciplines. Résultat : une population parmi les plus résistantes à la désinformation dans le monde. La Suisse : un modèle de coéducation En Suisse, l’éducation aux médias repose sur un dialogue permanent entre école, familles et médias. Des programmes locaux favorisent les débats intergénérationnels autour du numérique, et les élèves participent eux-mêmes à la création de contenus et aux débats. L’approche est collaborative, fondée sur la confiance et la participation de tous les acteurs éducatifs. La France : une structuration nationale Depuis 1983, la France dispose du CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information), qui coordonne les actions à l’échelle du pays. Il forme les enseignants, développe des ressources pédagogiques et soutient des initiatives scolaires comme la « Semaine de la presse et des médias à l’école (SPME) ». Ce modèle montre l’importance d’une stratégie nationale claire et soutenue par les pouvoirs publics. La Belgique : l’éducation par la pratique En Belgique, l’EMI s’est construite autour des initiatives de la société civile et de l’éducation populaire. Les jeunes y sont encouragés à devenir acteurs : à produire eux-mêmes des podcasts, des journaux ou des vidéos, pour mieux comprendre les mécanismes médiatiques. C’est une approche vivante, horizontale et participative, centrée sur l’expérimentation. Lire aussi : Internet sous pression : quand la désinformation cache la répression numérique Et le Cameroun dans tout ça ? Le Cameroun ne part pas de zéro. Il avance, mais sans cadre national solide. Dans les écoles, l’EMI reste peu présente. Pourtant, sur le terrain, des acteurs locaux innovent et agissent. Depuis quelques années, des initiatives locales émergent pour combler le vide laissé par l’absence d’une véritable politique nationale d’éducation aux médias et à l’information. Si l’école camerounaise reste encore peu outillée pour former les élèves à la lecture critique de l’information, des organisations de la société civile ont pris le relais, avec conviction et créativité. Parmi elles, Class Pro : qui en a fait un combat quotidien. Elle se distingue par son approche communautaire et critique. Fondée en 2022, l’association s’est donnée pour mission de rendre l’EMI accessible à tous les publics – jeunes, enseignants, journalistes, femmes et leaders communautaires à travers des projets comme #VOFEM, #JeunesVoixCritiques ou la Bourse EMI. Sa devise, « L’EMI sur tous les fronts », traduit bien sa vision : l’esprit critique est un outil d’émancipation et de justice sociale. Aux côtés de Class Pro, Eduk-Média. Pionnière et autre actrice clé, elle œuvre également à sensibiliser et former, notamment dans le milieu scolaire. L’organisation s’investit dans la production de contenus pédagogiques, la formation d’enseignants et la promotion d’un usage responsable du numérique. Ces deux acteurs illustrent la vitalité d’une société civile camerounaise qui ne se résigne pas à attendre des réformes venues d’en haut. Pourtant, le défi reste de taille : comment faire passer ces initiatives pionnières à l’échelle nationale ? Sans un cadre institutionnel clair, un appui public et une coordination entre les acteurs, l’EMI au Cameroun risque de rester cantonnée à des actions ponctuelles, alors qu’elle devrait devenir un pilier de l’éducation citoyenne et numérique. S’inspirer sans copier : vers un modèle camerounais S’inspirer de l’étranger, oui. Copier, non. Chaque pays a développé son approche en fonction de son histoire, de sa culture et de ses priorités. Le Cameroun, lui aussi, peut inventer sa propre voie, en combinant le meilleur des modèles existants : – De la Finlande, il peut tirer la rigueur pédagogique et la transversalité de l’enseignement critique. – De la Suisse, la co-construction entre acteurs éducatifs, médias et familles. – De la France, la structuration institutionnelle et la formation des enseignants. – De la Belgique, l’apprentissage par la pratique et la participation des jeunes. En adaptant ces forces à ses réalités locales : diversité linguistique, fractures numériques, contexte social et politique, le Cameroun peut bâtir une culture médiatique citoyenne et inclusive, au service de la démocratie. Lire aussi: Quand l’humour éveille l’esprit critique Construire notre propre modèle L’éducation aux médias n’est pas un luxe réservé aux pays du Nord. Elle est une condition de la liberté d’expression, du vivre-ensemble et du développement. Le Cameroun dispose déjà d’acteurs engagés, de jeunes créatifs, d’enseignants curieux et de médias désireux de mieux informer. Il ne manque plus qu’une vision partagée, une volonté politique et des synergies. Construire un modèle national d’EMI, c’est construire une société plus libre, plus critique et plus responsable. Au cœur de cette ambition, Class Pro porte une vision claire : « Faire de chaque citoyen un acteur éclairé et responsable du numérique, capable de naviguer, créer et collaborer dans un environnement digital inclusif, éthique et résilient, où l’éducation aux médias et à l’information est une priorité partagée par tous. » Surtout un environnement où chaque citoyen camerounais sache lire, comprendre et agir dans le monde médiatique. Le défi est grand, mais la route est tracée. Avec des acteurs engagés, des jeunes créatifs et des enseignants curieux, le Cameroun peut devenir